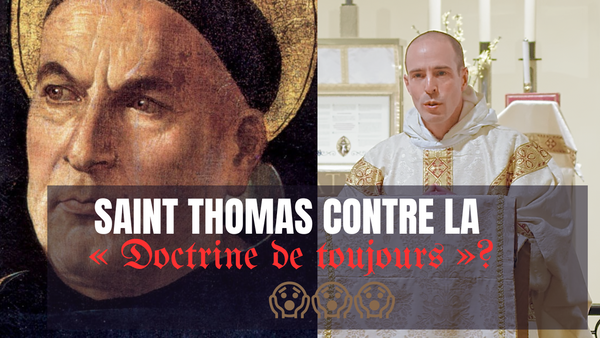Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement (Paris, Seuil, 2018, 284 pages)
Recension parue dans le n°145 de notre revue Sedes Sapientiæ
Un livre qui fera date
Comment est-on passé dans notre pays, en cinquante ans, de 94 % de baptisés catholiques, pratiquant à 25 %, à environ 30 % de baptisés [1], avec 2 % de pratiquants (tous les dimanches) ? L’auteur, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Est Créteil, reprend le dossier laissé, sur une note d’optimisme, au début des années soixante par le chanoine Boulard [2], spécialiste des études statistiques de la pratique religieuse dans l’Église. Guillaume Cuchet recherche les causes d’un tel effondrement et de la rupture, qu’il situe en 1965 ; et ce, dans une investigation large, sans sujets tabous, avec un ton dépassionné, évitant les termes polémiques des deux camps (traditionalistes, dits « intégristes », et progressistes) qui se sont opposés depuis le concile Vatican II. Ayant puisé aux meilleures sources chiffrées et recourant aux analyses de tous ses prédécesseurs, l’auteur entend réaliser la synthèse encore absente sur ce dossier. La lecture de l’ouvrage nous fait dire qu’il y réussit, par un remarquable équilibre des vues et par un pointage de faits trop souvent ignorés, aussi bien dans le temps court des époques charnières que dans le temps long du christianisme depuis la Révolution française. Ce livre fera date, comme une borne milliaire.
Une analyse variée et pertinente
Un regard sur les chapitres du livre montre la variété et la pertinence de l’analyse.
Le 1er chapitre est intitulé : La “carte Boulard”, lieu de mémoire du catholicisme français. L’auteur y analyse la genèse et la nature d’une célèbre carte, photographiant la pratique religieuse de la France rurale [3]. Il en montre la stabilité depuis la Révolution, où l’attitude du clergé local devant la Constitution civile du clergé fut comme un « referendum » : les non-assermentés faisant passer leur paroisse dans la catégorie À « pratique majoritaire » (40 % d’adultes pascalisants).
Le chapitre 2, Le tournant de 1965, est le plus décisif pour marquer la date du tournant. L’auteur procède à partir d’enquêtes statistiques réalisées à Rouen, Saint-Fulgent, Paris, Lille, Poitiers, montrant surtout la spectaculaire chute (une division par deux ou quatre), en quelques années, de la pratique des jeunes de 12 à 25 ans.
Au chapitre 3, Les causes de la rupture, l’auteur analyse plusieurs facteurs de la rupture. Il dédouane, peut-être un peu vite, le train des réformes liturgiques commençant dès 1964, après les expérimentations largement répandues avant le concile ; tout en reconnaissant combien la stabilité des pratiques religieuses dans les grands sanctuaires a freiné la chute. Il évoque l’affaissement du cadre religieux, notamment avec la mise en avant de la liberté ou de la sincérité du croyant, et la « sortie collective de la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel » (p. 135). « La sanctification des dimanches et fêtes, les pratiques dominicales et pascales, la confession annuelle, le respect des règles alimentaires du jeûne et de l’abstinence, en particulier le vendredi, étaient ainsi les principaux “devoirs religieux” du chrétien » (p. 137). L’hypothèse de l’auteur est que la « fin de l’insistance pastorale sur le caractère obligatoire de la pratique survenue à la faveur du concile a joué, sur le plan collectif, un rôle fondamental dans la rupture, comparable à la fin de l’obligation civile sous la Révolution » (p. 142).
En revanche, l’auteur note, dès 1963, un durcissement par le clergé des conditions d’accès à la communion solennelle et au mariage. Il souligne à maintes reprises ce regard plutôt négatif du clergé de l’époque sur les catholiques dit « sociologiques », ceux qui pratiquent aux fêtes et lors des « rites de passage » (baptême, communion solennelle, mariage, enterrement…), avec l’agacement d’un trop-plein de jeunes (ceux de la génération baby-boom), qui ne persévéraient pas pour la plupart.
L’auteur conclut : « Je résumerais donc volontiers le propos en disant que le décrochage des jeunes a été le fait générateur de la crise (au sens de facteur principal) et qu’il a procédé d’un triple effet cumulé d’âge (le décrochage postcommunion), de génération (les baby-boomers) et de période (Vatican II et mai 68, notamment) » (p. 154).
Le chapitre 4, Les différentes temporalités de la déchristianisation, repart du choc de la Révolution française qui fixa, selon le refus ou l’acceptation de la Constitution civile du clergé par les curés, la carte de la pratique des paroisses pour plus de cent cinquante ans. Rappelant le rapide renouveau en nombre du clergé sous la Restauration, et les belles années, en fondations et missions, du catholicisme sous le Second Empire, l’auteur note toutefois que la tendance de fond durant le XIXe siècle et la première moitié du XXe fut une lente déchristianisation, quoiqu’avec de grandes inégalités selon les régions et les périodes et avec des reprises partielles.
Le chapitre 5, La crise du sacrement de pénitence, est le plus élaboré. Il montre « l’explosion nucléaire » de ce sacrement, la disparition du groupe des fervents qui se confessaient une fois la semaine, les femmes surtout. En 1983, près de 70 % des catholiques ne se confessent plus du tout. Parmi les causes recensées, il y a, de façon cumulative : la déconsidération par nombre de prêtres de la vie intérieure et de ce sacrement (jusque dans son mobilier, le confessionnal) ; le silence sur le péché grave et les fins dernières dans la prédication ; la banalisation de la communion sans la préparation par ce sacrement ; l’impact d’Humanæ vitæ ; le nouveau rituel et les hésitations sur les absolutions collectives… L’auteur avance deux hypothèses d’interprétation complémentaires. L’une est directement liée à l’histoire du catholicisme : c’est l’affaissement des motivations spirituelles, comme la crainte de l’enfer, et l’évanouissement du cadre des obligations légales. L’autre est culturelle : la campagne contre la culpabilité des années 60-70, influencée par la psychanalyse (« l’univers morbide de la faute ») et les thèses de Jean Delumeau sur la « pastorale de la peur ».
Le chapitre 6, La fin du salut ? La crise de la prédication des « fins dernières », aborde un thème rarement évoqué comme cause de la déchristianisation : la fin de la prédication sur les fins dernières. Depuis l’après-guerre, le sujet, dénaturé par les théologiens en pointe (Balthasar, Congar) est devenu tabou – il l’est encore aujourd’hui dans les cérémonies de sépulture [4]. L’auteur évoque l’influence de deux livres célèbres de Hans Urs von Balthasar (cf. p. 261).
Il avance la politisation de la chaire chrétienne, parmi un ensemble de facteurs : « L’abandon de la soutane (dès 1962) et de l’habit religieux, la politisation (à gauche généralement) du clergé, les départs de prêtres, de religieux et de religieuses, parfois suivis de leur mariage, sont apparus à beaucoup comme une véritable “trahison des clercs”, sans équivalent depuis les “déprêtrisations” de la Révolution, qui a eu les mêmes effets déstabilisants » (p. 135). Mais il ne souligne pas assez que la marxisation et la « tiers-mondisation » de la prédication a indisposé, voire écarté toute une partie des fidèles, et a contribué à rabaisser pour tous l’horizon eschatologique.
Est évoquée aussi la fin de la thèse sur le petit nombre des élus depuis le milieu du XIXe siècle, ainsi qu’une déformation de la prédication sur la miséricorde au début du XXe siècle. L’auteur mentionne « la poursuite du mouvement d’évolution de l’image de Dieu dans le sens d’une accentuation croissante de sa dimension miséricordieuse » (p. 251). Mais, si la publication de l’Histoire d’une âme de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus en 1898 a joué en effet un rôle important dans l’accentuation de la miséricorde (cf. pp. 245-246 et 251-252), ce n’est que par une interprétation unilatérale de la doctrine de la sainte (qui avait été marquée de façon décisive par le livre de l’abbé Arminjon sur les fins dernières) que cela a contribué à la disparition du thème des fins dernières.
Le rôle de Vatican II, question disputée
C’est surtout le rôle du concile Vatican II qui retient l’attention de l’auteur. L’auteur lui attribue, de façon nuancée, une influence décisive mais plutôt indirecte. C’est un événement déclencheur, non la cause principale de la crise.
Citons-le. « D’où cette rupture, puisque rupture il y a eu, a-t-elle donc bien pu venir ? Il faut qu’il y ait eu un événement derrière un phénomène de cet ordre, au moins pour le provoquer. Mon hypothèse est qu’il s’agit du concile Vatican II. On ne voit pas en effet quel autre événement contemporain aurait pu engendrer une telle réaction. […] Le concile Vatican II me paraît avoir provoqué de manière indirecte l’évanouissement d’un système qui était probablement, au demeurant, sérieusement miné de l’intérieur, sans quoi on s’expliquerait mal qu’il ait pu s’effondrer si subitement et avec si peu de résistance » (pp. 130 et 256). C’est au « catholicisme français » qu’il attribue, avec l’image suggestive d’un « accès de rousseauisme », la causalité directe dans l’évacuation radicale d’une part de la doctrine. « Le catholicisme français a effectivement connu, à la faveur du concile et de la crise qui a suivi, un accès de rousseauisme collectif […]. Dans le déménagement général dont le concile a donné le signal, il [le catholicisme français] s’est débarrassé sans phrase de pans entiers de l’ancienne doctrine auxquels il ne croyait plus guère et qui lui sont soudain apparus comme des vieilleries théologiques et dévotionnelles inutiles et coûteuses [5] » (pp. 264-265).
L’auteur pointe aussi les effets d’ébranlement indirects du concile dans le changement de perspective de l’ecclésiologie et les rapports avec les autres religions et avec la volonté d’ouverture vis-à-vis des non-catholiques (notamment pp. 248 et 257).
Cette thèse centrale sur le rôle déclencheur de Vatican II d’une rupture dans les masses aurait gagné à être confirmée par des appuis textuels, en reprenant quelques titres de grands journaux, des publicistes, et des déclarations de prélats français pour mettre ce rôle en relief. Sur l’influence des textes même du concile sur la crise, l’auteur est plus hésitant, hormis pour la déclaration sur la liberté religieuse. Il souligne plutôt la faible place des rappels doctrinaux sur les fins dernières et les commandements de l’Église, au profit d’autres préoccupations des pères conciliaires.
Le cas particulier de la liberté religieuse
Tout en affirmant que « le concile lui-même (dans ses textes) » n’a pas de responsabilité directe sur la « rupture de la pratique des années 1965-1966 » (p. 131), l’auteur se demande s’il ne faut pas faire une exception pour le fameux texte sur la liberté religieuse Dignitatis humanæ. Il émet l’hypothèse que cette déclaration, n’ayant pas grand-chose à conquérir ad extra dans la sphère civile des pays occidentaux, où « l’égalité des cultes était acquise depuis longtemps », elle aurait eu son effet ad intra. « Le texte a pu ainsi apparaître comme une sorte d’autorisation officieuse à s’en remettre désormais à son propre jugement en matière de croyances, de comportements et de pratique » (p. 132). L’hypothèse ne manque pas de vraisemblance, sans pourtant que l’on puisse aller jusqu’à parler, comme le fait l’auteur, de « consécration de la liberté de conscience par le concile » (p. 257).
Si la déclaration sur la liberté religieuse a conduit les chrétiens à se croire libres en conscience de faire un choix dans la pratique, c’est qu’a prévalu une lecture erronée du texte, appuyée par le courant progressiste. La déclaration parle en fait, non de la « liberté de conscience », mais de la non-coercition de l’État vis-à-vis des pratiques religieuses, dans la limite du bien commun, comme le précisera utilement le Catéchisme de l’Église catholique en 1992 [6]. La fausse interprétation a indéniablement refroidi la mission vis-à-vis des peuples non chrétiens, dont la liberté a été comprise comme le droit personnel à pratiquer leur fausse religion plutôt que le droit d’écouter l’annonce de l’évangile.
Les causes probables de la crise
Considérant la crise comme inévitable en raison du choc socio-culturel des années soixante, l’auteur ne voit que deux hypothèses pour expliquer le rôle déclencheur de Vatican II : soit une « crise violente de rattrapage provoquée par la réforme trop tardive d’une vieille institution conservatrice » ; soit une « sortie de route imprévue d’un processus de modernisation bien mené, mais qui a eu le malheur de coïncider avec une mutation sociale massive, ayant soudainement gonflé ses voiles de vents contraires, surtout à partir de 1968 » (p. 272).
Il nous semble qu’une troisième hypothèse peut être émise, sur le thème du « rousseauisme » déjà mentionné : une méprise initiale sur les potentialités évangéliques d’une ouverture à un monde en révolution hédoniste. Certains textes étonnamment optimistes (Gaudium et spes) ou faibles et équivoques en leurs considérants (Dignitatis humanæ) ont favorisé la confusion des esprits parmi les fidèles et les fermentations révolutionnaires des clercs progressistes ; le tout préparé, amplifié et ressassé depuis cinquante ans par les mass-media.
Remarques et pistes de réflexion
Signalons de rares naïvetés théologiques ou d’analyse. L’auteur semble s’étonner de constater que les milieux progressistes transmettent moins à leurs enfants. (cf. pp. 267-268), alors que l’idéologie du progrès relativise, sinon déprécie, toutes les convictions du passé et donc celles des parents eux-mêmes au regard de leurs enfants.
L’auteur reconnaît que l’étude des années cinquante donnerait la clé de nombre de questions sur la rupture de la décennie 1960. Elle éclairerait notamment la question de savoir pourquoi la génération parentale des baby-boomers est la première dans notre histoire qui a lâché le flambeau de la transmission de la pratique familiale, à l’âge de la communion solennelle de leurs enfants. Il en appelle, en conclusion de son livre, à des monographies sur les diocèses et même sur les familles pour mieux comprendre sur trois générations la non-transmission de la pratique.
Le corps de l’ouvrage et sa conclusion pointent en filigrane les erreurs et démissions des élites progressistes de l’Église de France. Et ce sont bien les analyses des milieux conservateurs ou traditionnels qui auront été, quoique parcellaires et parfois passionnées, les plus lucides sur ce drame ; enfin, comble d’irrévérence, le concile Vatican II est signalé comme le déclencheur auprès des masses occidentales de la révolution qui avait gagné le clergé depuis l’après-guerre.
Tout autant qu’une crise de la foi et de l’identité chrétienne dans le monde en rapide changement des années soixante, c’est une crise du courage dans la chaire chrétienne qui a provoqué la catastrophe. C’est notamment l’arrêt de la prédication sur des points comme : « l’assistance à la messe du dimanche est une obligation grave » ; « les fins dernières sont une réalité à toujours regarder en face », « la damnation est une tragique possibilité » ; « il est impérieux de se confesser régulièrement ». Ces silences de l’Église enseignante auront été lourds de conséquences dans la déchristianisation massive de la France. Oubli tragique de la recommandation de saint Paul à Timothée : « Insiste à temps et à contretemps, réfute, exhorte, menace. Un temps viendra où l’on ne voudra plus entendre la saine doctrine » (2 Tm 4, 2-3). Quelle invitation pressante aux prédicateurs actuels de ne rien cacher des vérités évangéliques qui fâchent le monde !
Fr. Alain-M. Froment
Présentation auteur
Le Frère Alain-Marie Froment est diacre, religieux de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier.
[1] Il s’agit des chiffres des baptêmes pour la génération naissante, non du pourcentage par rapport à l’ensemble de la population (cf. pp. 13-16).
[2] Ce dernier écrit en 1966 : « […] on oserait écrire que le problème apostolique numéro 1, maintenant, en France, n’est plus celui de la quantité de pratiquants, mais leur qualité chrétienne » (cité p. 103).
[3] La « carte Boulard », reproduite p. 34, est une « carte religieuse de la France rurale » parue dans les Cahiers du clergé rural en novembre 1947. Elle classe les cantons en « paroisses chrétiennes » (40 % d’adultes pascalisants ou assistant au moins une fois sur deux à la messe dominicale), « paroisses indifférentes à tradition chrétienne », pays de mission (au moins 20 % d’enfants non baptisés ou catéchisés), protestants (au moins 500 protestants ruraux).
[4] On pourrait ici évoquer aussi le rôle néfaste de la Nouvelle théologie comme telle. Issue de l’école jésuite de Fourvière, la tendance anti-spéculative de ce courant et son mépris du passé médiéval scolastique a imprégné toute l’Église de France.
[5] Cette remarque sur le manque de foi dans des pans entiers de l’ancienne doctrine vaut surtout pour les minorités cléricales et laïques activistes, relayées par les medias, qui ont œuvré pour imposer des changements. Beaucoup de prêtres et de fidèles les ont plutôt subis à contre-cœur.
[6] « Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité (cf. Pie VI, bref Quod aliquantum), ni limité seulement par un “ordre public” conçu de manière positiviste ou naturaliste (cf. Pie IX, encyclique Quanta cura). Les “justes limites” qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l'autorité civile selon des “règles juridiques conformes à l’ordre moral objectif” (DH 7) » (Catéchisme de l’Église Catholique, n° 2109).